par Christine Erhel & Bruno Palier , le 9 septembre
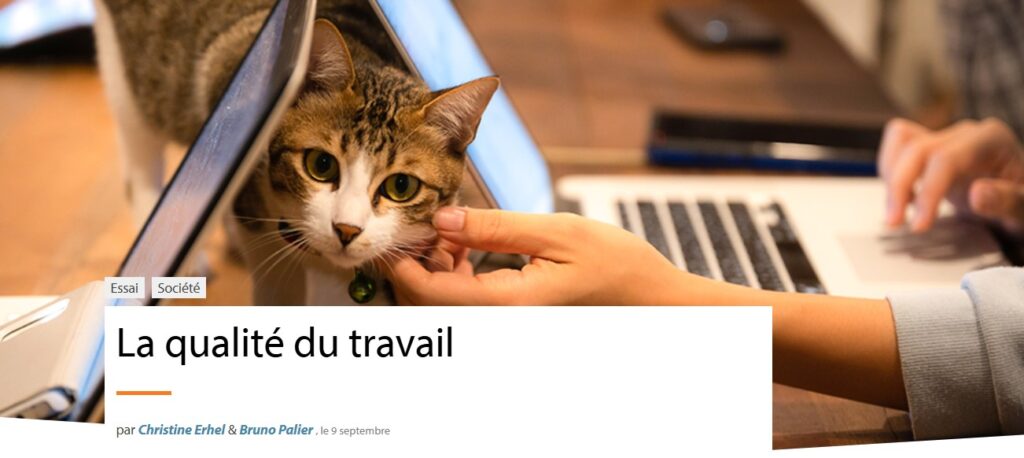
Bien qu’attachés à leur travail, les Français souhaitent en améliorer les conditions et la reconnaissance. Un enjeu tout à la fois social, économique, politique et environnemental.
Ce texte constitue l’introduction de l’ouvrage Travailler mieux, qui paraît ce mois-ci dans le cadre de la collection Puf/Vie des idées
Les Français sont parmi les Européens les plus attachés au travail, près des deux tiers d’entre eux affirmant que le travail est très important [1]. Cependant, pour beaucoup, la vie au travail en France est difficile : le nombre d’accidents du travail y est largement supérieur aux moyennes européennes (3,32 accidents mortels pour 100 000 personnes en emplois en France en 2021, contre 2,66 en Italie, 1,54 en Pologne, 0,84 en Allemagne, 0,77 en Suède ou 0,33 aux Pays-Bas, selon Eurostat), les conditions de travail sont souvent moins bonnes qu’ailleurs en Europe [2] ; de nombreuses personnes manquent de reconnaissance pour les tâches accomplies ; problèmes de santé au travail et perte de sens gagnent de nombreuses professions, y compris celles d’encadrement (perte de vocation des managers) [3].
Pour un nombre important de personnes, le travail est devenu insoutenable, notamment du fait de son intensification. Cela est particulièrement vrai pour le travail en seconde ligne [4] ou dans les métiers de la propreté [5], mais aussi, pour des raisons différentes, pour de nombreux cadres [6].
Face aux défis posés par les difficultés du travail en France, dans un contexte de mutation technologique et de transition écologique, cet ouvrage propose des pistes pour une meilleure qualité du travail et de l’emploi. Comment améliorer les conditions de travail, alléger les contraintes horaires, au bénéfice de la santé ? Comment répondre aux exigences de sens et de bien-être au travail ? Comment instaurer la démocratie au travail ? Comment changer les modalités d’organisation et de management du travail ? Comment utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le travail ? Comment travailler à l’heure du changement climatique et des exigences de la transition écologique ? L’ouvrage s’appuie sur des expériences et des exemples qui ont fait leurs preuves dans les entreprises et dans les politiques publiques, en France mais aussi à l’étranger. Il construit une stratégie de qualité pour toutes et tous, en rupture avec les orientations et pratiques des dernières décennies. Mais avant de détailler ces propositions, il convient d’approfondir le diagnostic.
Le malaise du travail en France
Parmi d’autres, l’ouvrage Que sait-on du travail ?, qui s’appuie sur de nombreux travaux de recherche en sciences sociales, documente et explique ces situations difficiles. Il y est montré que les modalités d’organisation du travail sont déterminantes pour expliquer les difficultés rencontrées. Les salariées et salariés sont de plus en plus souvent soumis à un management par les chiffres, hiérarchique, vertical et distant, qui laisse peu de place à l’autonomie et à l’horizontalité, et tient rarement compte de la réalité des conditions de production, ou des retours que les personnes concernées souhaiteraient pouvoir faire sur l’organisation du travail [7].
La digitalisation a transformé le travail, mettant fréquemment les humains au service des machines, plutôt que l’inverse. Ainsi, les travailleurs de la logistique en entrepôt, de l’industrie automobile ou du service à domicile deviennent les simples bras d’un algorithme qui dicte les tâches à accomplir, avec comme principale finalité l’intensification et le contrôle de la productivité. Le télétravail a pu avoir des conséquences délétères du fait de la porosité accrue entre vie professionnelle et familiale, tout particulièrement pour les femmes.
Les situations ne sont pas uniformes. De nombreuses inégalités persistent au travail, le plus souvent en défaveur des moins qualifiés, des femmes, de certains jeunes, des handicapés et des personnes issues de l’immigration, et cela malgré la multiplication des plans d’action. Les femmes ont aujourd’hui des taux d’emploi similaires à celui des hommes, mais elles travaillent beaucoup plus souvent à temps partiel, sont moins rémunérées que les hommes, et leurs carrières restent bloquées par un plafond de verre. Elles sont en outre surreprésentées dans certaines professions, notamment les professions reconnues comme « essentielles » pendant la crise du Covid. Ce sont les personnes qui ont dû sortir de chez elles pour aller travailler auprès des autres pendant les confinements de 2020 et 2021. Leur contribution a été soulignée : sans elles, notre économie et notre société ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Pourtant, ces professions essentielles (de la santé, du soin, de la sécurité, du nettoyage, du commerce, de la logistique, des transports, de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau, etc.) sont le plus souvent des professions mal considérées, mal rémunérées, mal protégées, et elles le sont restées après 2020.Si les désavantages se cumulent fréquemment, certaines professions autrefois considérées comme protégées subissent elles aussi les conséquences négatives de l’intensification du travail (voir les burn-out chez les cadres).
Les difficultés au travail se donnent à voir de multiples façons. Les Françaises et Français manifestent contre une réforme des retraites qui leur demande de travailler plus longtemps dans des conditions perçues par beaucoup comme insoutenables. De nombreux secteurs se retrouvent « en tension » (les employeurs n’arrivent plus à recruter) du fait de rémunérations trop faibles pour des conditions de travail trop difficiles. La Dares, (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge des questions du travail et de l’emploi) montre que les secteurs où les entreprises déclarent le plus rencontrer des difficultés de recrutement sont la construction, l’hébergement et la restauration, l’agroalimentaire, la fabrication de biens d’équipement et les transports et l’entreposage, secteurs dans lesquels les conditions de travail sont particulièrement difficiles et les niveaux de rémunération souvent plus faibles. La qualité de vie au travail devient ainsi une préoccupation majeure des partenaires sociaux comme des directions des ressources humaines. Comme l’a montré Thomas Coutrot parmi d’autres, les difficultés au travail participent aussi de la crise démocratique actuelle [8].
Alors que les maux du travail sont au cœur des préoccupations publiques, il est nécessaire de réfléchir aux solutions permettant d’améliorer la qualité du travail en France. Cette réflexion apparaît d’autant plus importante que le travail se trouve de plus en plus sous pression des multiples transformations en cours, technologiques, environnementales, sociales et politiques…
Un monde du travail en transformation et en tension
La réflexion sur l’amélioration des conditions de travail et d’emploi s’inscrit dans un contexte général de tensions, liées à de multiples facteurs. En premier lieu, la poursuite du développement des outils numériques et le développement de l’intelligence artificielle constituent une vague d’innovations bien particulière, qui génère des craintes de plus en plus fortes de remplacement de l’homme par la machine, y compris dans des tâches intellectuelles, mais qui ne semble pas pour autant dynamiser la croissance de la productivité du travail. En effet, la croissance de la productivité a fortement ralenti et n’est plus que de 0,4 % par an en France (et 0,6 % en Europe) sur la période 2003-2023, générant une croissance économique elle-même faible, qui ne permet pas une amélioration visible des conditions de vie par rapport à la génération précédente et dont la faiblesse pèse sur le financement de notre protection sociale. Or, si l’on suit des auteurs comme Robert Gordon, cette tendance n’a aucune raison de s’inverser, parce que les nouvelles inventions, moins radicales, ont moins d’effets économiques qu’autrefois, même si elles semblent incessantes [9].
Il reste sans doute possible d’améliorer les performances et la croissance de la productivité en investissant dans la recherche et le développement, l’éducation et l’accueil d’immigrants qualifiés, mais les politiques actuelles n’en prennent pas le chemin. Si les perspectives de croissance ne sont pas au rendez-vous, l’essor du numérique a cependant transformé le monde du travail, en détruisant certains emplois qui comportent des tâches routinières [10], manuelles ou de bureau (feuille de paye, gestion de bases de données, comptabilité…), dont une part importante se situe au milieu de la hiérarchie sociale, affaiblissant les classes moyennes. Avec le développement de l’intelligence artificielle (IA), cette fragilisation va probablement s’étendre à certains emplois qualifiés comportant de la manipulation d’images, de logiciels ou de documents. Cela ne signifie pas nécessairement que ces emplois vont disparaître, ils peuvent se maintenir, mais voir leur contenu profondément transformé, avec un risque de perte de sens et de dévalorisation. De plus, ces fragilisations et transformations génèrent de nouvelles inégalités sociales, qui traversent la structure des professions et catégories sociales en touchant des emplois relativement qualifiés, tandis que certains métiers peu qualifiés sont en croissance et en tension – sans pour autant bénéficier de hausses salariales substantielles –, notamment ceux du soin et du lien.
Un second facteur de transformations de la structure de l’emploi et du contenu du travail provient de la transition écologique. Dans l’ensemble, les évaluations existantes (comme celles de l’Ademe – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) mettent en évidence un potentiel de création d’emplois liée à la transition climatique de plus de 340 000 emplois équivalent temps plein à horizon 2035, et 900 000 à l’horizon 2050. Toutefois, ces créations d’emploi sont conditionnées à un réel investissement dans la transition et à des dépenses publiques supplémentaires (près de 30 milliards par an selon le rapport de Jean Pisani et Selma Mahfouz de 2023 [11]), consacrées à la rénovation des bâtiments publics, aux transports, à de subventions aux entreprises et aux ménages. De plus, elles impliquent également un effort de formation et de soutien aux transitions professionnelles, face à des besoins en compétences spécifiques et à des pertes d’emplois dans certaines activités (voitures thermiques par exemple). Enfin, les emplois verts ou « verdissants » (avec un contenu écologique même si ce n’est pas leur finalité principale) se caractérisent parfois par des conditions de travail difficiles, par exemple dans le traitement des déchets, ou même l’agriculture biologique, qui supposent un accompagnement spécifique.
Ces transformations technologiques et écologiques prennent place dans un contexte de crises à répétition, largement externes au monde économique, mais avec des conséquences fortes sur les ménages et les entreprises. Ce contexte de risques et de crises constitue une troisième composante de l’environnement du travail en tensions. C’est évidemment le cas de la crise sanitaire de 2020, crise exogène par excellence, qui a profondément transformé la gestion des ressources humaines et les politiques de l’emploi. Les pouvoirs publics ont eu massivement recours à des dispositifs d’activité partielle, permettant le maintien en emploi avec un coût très faible pour l’entreprise : selon les estimations de l’OCDE, au pic de la crise Covid, 1 emploi sur 5 était concerné par le chômage partiel, et plus de 30 % en France [12]. Certes, ces dispositifs existaient déjà et avaient fait l’objet d’une utilisation réussie pendant la crise financière de 2008, mais avec une ampleur beaucoup plus limitée. Malgré son importance, le recours à l’activité partielle ne saurait toutefois résumer la palette des stratégies mises en œuvre dans les entreprises. Celles-ci ont également eu recours au télétravail lorsque c’était possible, avec une émergence de modes d’organisation hybrides entre travail à distance et travail sur site dès que les conditions sanitaires le permettaient. Ces organisations hybrides se sont maintenues et le télétravail concerne aujourd’hui plus d’un salarié du secteur privé sur cinq, avec un rythme le plus souvent normalisé à deux jours par semaine dans les accords d’entreprises. Mais les entreprises ont également utilisé des stratégies de flexibilité externe, en réduisant temporairement le volume de salariés en CDD ou en intérim, ou de développement de nouvelles activités avec maintien du travail en présentiel (par exemple production de masques ou de gel hydroalcoolique) ou encore des stratégies mixtes, combinant ces différents leviers d’ajustement [13]. Si cet ensemble de réactions a permis un maintien de l’emploi malgré les restrictions sanitaires, la question de l’efficacité de ces stratégies de réponse à la crise sanitaire en termes de performances économiques se pose (notamment en matière de productivité, compte tenu des tendances évoquées précédemment), et devra faire l’objet d’évaluations sur la base des données disponibles.
La crise sanitaire a également fait émerger de nouvelles catégories d’analyse des métiers, en soulignant le rôle de certains métiers en termes de continuité de la vie économique et sociale. Ces métiers « essentiels », selon la terminologie du BIT, se situent dans des secteurs divers, santé, sécurité, transports et logistique, commerce, aide à domicile, agriculture… et pour la plupart ne peuvent être exercés qu’en présentiel. En France, ils ont été qualifiés de « métiers de la première et de la seconde ligne », selon leur degré d’exposition directe aux malades de la COVID, d’après un discours d’Emmanuel Macron du 13 avril 2020 [14]. Ils représentent 7,7 millions de salariés en 2021, soit 32 % de l’emploi [15]. Si la crise les a mis en lumière, elle n’a pas pour autant conduit à une amélioration de leur situation, notamment salariale [16].SDans un monde marqué par l’incertitude et les tensions géopolitiques, où de nouvelles crises sont probables, l’analyse des outils d’ajustement et des modalités de soutien aux emplois « essentiels » apparaît très importante.
Enfin, le contexte politique et social a évolué et modifié les attentes à l’égard du travail. Si le travail reste aujourd’hui très important aux yeux des Français (62 % des Français déclarent que le travail est très important dans l’enquête European Value Survey – EVS – de 2017 [17]), on constate une importance accrue donnée au sens du travail, facteur primordial de satisfaction au travail selon les données de l’enquête internationale International Social Survey Program (ISSP). Pour la France, les analyses empiriques de Thomas Coutrot et Coralie Perez à partir des enquêtes sur les « Conditions de travail » (2013 et 2016) vont au-delà des effets sur la satisfaction déclarée et montrent un lien direct entre le sens du travail – mesuré à partir de l’utilité sociale, de la cohérence éthique, des capacités de développement des compétences – et les comportements des salariés en termes de démissions, de risques d’absence pour maladie ou de dépression [18]. Selon ces mêmes chercheurs, le sens du travail est fort pour des métiers qui ne se situent pas forcément en haut de l’échelle sociale ou de l’échelle des salaires (assistante maternelle, aide à domicile, ouvrier qualifié du BTP, employé administratif et commercial du tourisme), tandis que les métiers les plus dénués de sens incluent à la fois des métiers de service peu qualifiés (caissière, agent de sécurité, etc.) et des métiers qualifiés plutôt bien rémunérés, comme les conseillers et cadres de la banque et des assurances [19]. Cette faiblesse du sens réduit l’attractivité de certains métiers – pourtant nécessaires à la société –, surtout si elle est accompagnée de difficultés liées à la soutenabilité du travail, dans une perspective d’allongement des carrières (en 2019, 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite [20]). Mettant en évidence que l’importance du travail va bien au-delà de la sphère productive, des travaux récents ont montré les liens entre les conditions de travail et le vote : ainsi, les horaires atypiques, la pénibilité physique et l’absence d’autonomie au travail sont associés au vote Rassemblement national et/ou à l’abstention [21].
Que faire pour améliorer la qualité du travail ?
Dans ce contexte de transformations et de défis, la question du travail est fondamentale pour la cohésion sociale et l’avenir de la démocratie, tout autant que pour une croissance économique soutenable. Elle ne peut pas être traitée au travers d’une perspective uniquement quantitative de créations ou de destructions de l’emploi, mais nécessite une attention sur la qualité du travail et de l’emploi dans ses différentes dimensions.
En se concentrant en premier lieu sur la lutte contre le chômage par la réforme du marché du travail et l’affaiblissement des protections des salariés, les politiques françaises n’ont pas été à la hauteur des enjeux de transformation du travail. En effet, les politiques de l’emploi ont été marquées par deux grands axes depuis la crise financière de 2008 : la poursuite de la logique de baisse du coût du travail, lancée avec les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires en 1993 ; et la flexibilisation du droit du travail.
Sur le premier point, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE adopté en 2013), puis le pacte de responsabilité (2014) ont conduit à étendre les baisses de coût du travail jusqu’à des niveaux de rémunérations relativement élevés, au nom de la compétitivité prix de l’industrie française. Mais ces mesures n’ont pas fait la preuve de leur efficacité [22]. Par ailleurs, elles ont sans doute limité les efforts nécessaires pour améliorer la qualité des produits comme du travail, freinant la montée en gamme de l’économie française [23].
Sur le deuxième point, les lois puis ordonnances travail (adoptées en 2018) ont contribué à réduire la protection des salariés, notamment en cas de licenciement, mais aussi à décentraliser la négociation collective vers l’entreprise sans réellement renforcer les instances de représentation du personnel, marquées par la création du Comité social et économique (CSE), aux prérogatives très larges. Un résultat paradoxal de cette réforme, supposée dynamiser le dialogue social en entreprise, est la baisse de la couverture des salariés par les instances représentatives du personnel (IRP) depuis la réforme, le travail de représentant étant jugé trop complexe et peu attractif [24]. De plus, sauf dans les grandes entreprises d’au moins 300 salariés, il n’existe plus d’instance obligatoire dédiée au suivi des conditions de travail et de santé des salariés, comme auparavant le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et la présence de représentants de proximité demeure très limitée (1,6 % des entreprises). Or le dialogue social constitue un outil fondamental d’ajustement des entreprises aux transformations technologiques en cours, à la transition écologique, voire aux crises majeures qui marquent l’économie mondiale [25].
Un ouvrage pour proposer des orientations positives
Il est aujourd’hui nécessaire de réorienter les politiques françaises en faveur de la qualité de l’emploi et du travail. Pour ce faire, de nombreuses questions concrètes se posent. Comment faire évoluer le management à la française, trop vertical et distant ? Comment organiser la prise de parole des salariés au sein des entreprises, des services, des unités ? Qui pour prendre la parole, dans quel contexte, avec quelle finalité ? Comment organiser la participation des salariés aux décisions qui les concernent (définition des tâches, de la production, de la stratégie des organisations) ? Comment rendre compatibles les temps du travail et de la vie personnelle ? Comment faire des transitions digitales et environnementales des opportunités pour les personnes au travail ? Comment améliorer la reconnaissance de l’utilité collective de nombreuses professions ? Comment mieux rémunérer les professions dites « essentielles » ?
Les travaux de recherche sur le travail peuvent contribuer à y répondre. Les analyses des psychologues, économistes, sociologues du travail, des sciences de gestion, des ergonomes, des juristes ou politistes travaillant sur ces questions permettent de documenter et de comprendre les multiples mécanismes à l’origine des difficultés au travail, et peuvent donc proposer des moyens d’y remédier. Ces travaux ont permis d’identifier les expériences, les organisations, les modes de management, les situations, les mesures qui ont fait leurs preuves en matière d’amélioration des conditions de travail, de santé, de sens, de bien-être au travail et qui, en parallèle, peuvent contribuer à plus de productivité et de performance soutenable pour les entreprises. Il est donc possible de fonder des propositions sur des analyses académiques, des recherches et des études qui ont prouvé que des objectifs d’amélioration ont été atteints (des expériences « qui marchent », des « bonnes pratiques »). C’est le principe du recueil de propositions publiées sur le site de La Vie des idées : rassembler des mesures concrètes proposées par des chercheuses et chercheurs des sciences humaines et sociales du travail, fondées sur leur savoir et leurs observations, menées aussi bien en France qu’à l’étranger. C’est aussi le principe de l’ouvrage que nous présentons ici : Travailler mieux.
Le premier chapitre propose des mesures générales pour améliorer la qualité des emplois et du travail. Christine Erhel invite tout d’abord à mettre en place un observatoire de la qualité de l’emploi et du travail qui publierait régulièrement un index, sur la base de six critères principaux, à l’image de ce qui se fait dans de nombreux pays européens. Elle rappelle ensuite comment il est possible de donner les moyens à tous les salariés d’avoir une part de contrôle sur leurs horaires, même lorsque ceux-ci sont atypiques. Elle appelle finalement à la mise en place d’un « salaire vital » de référence pour la France, à l’aune de ce qui est proposé par l’Organisation internationale du travail (OIT).
Thomas Coutrot et Coralie Perez rappellent les difficultés du dialogue professionnel et proposent d’instaurer un droit d’avoir son « mot à dire » sur son travail. Celui-ci passe par l’instauration d’une nouvelle instance de représentation élue sur liste syndicale, le « délégué au travail réel » et la rénovation du droit d’expression des personnes au travail par la mise en place d’un temps dédié à celle-ci hors présence des managers, avec obligation pour la direction de répondre aux points soulevés ou proposés lors de ces temps d’expression. La participation des salariés aux décisions qui concernent leur activité de travail contribue à donner du sens au travail et doit contribuer à rééquilibrer des rapports de pouvoir par trop déséquilibrés.
Comment améliorer durablement le management à la française ? Laurent Cappelletti rappelle combien ses défaillances liées à sa verticalité sont source de pertes de sens pour les salariés, de productivité et de ressources pour les entreprises. Il propose tout d’abord une méthode pour mesurer les pertes financières liées aux défaillances de management. Il insiste sur la nécessité pour les managers de chercher des solutions négociées aux problèmes rencontrés, dans les six grands domaines qui forgent la qualité du management : 1. les conditions de travail tant physiques que psychologiques ; 2. l’organisation du travail ; 3. la communication-coordination-concertation et le sens au travail ; 4. la gestion du temps ; 5. la formation et l’évolution professionnelles ; 6. la mise en œuvre stratégique (en particulier les stratégies de rémunérations et de répartition de la valeur économique créée). Les propositions reposent sur de nombreux exemples de pratiques vertueuses, au sein de très petites ou de grandes entreprises.
Comment mettre l’intelligence artificielle au service des travailleurs ? Après avoir rappelé les risques que l’IA fait peser sur le travail, et les différents scénarios de son développement, Jérôme Gautié et Coralie Perez appellent à renforcer la capacité des travailleurs à faire entendre leur voix face aux transformations à l’œuvre, dans la recherche de compromis négociés entre les acteurs sociaux. Il faut ainsi favoriser un effort important de formation aux transformations numériques pour les salariés et en particulier pour leurs représentants syndicaux et le délégué au travail réel proposé dans le chapitre de Thomas Coutrot et Coralie Perez. Il faut aussi renforcer le système d’expertise et d’appui à la négociation existant, créer des observatoires paritaires des usages et effets de l’IA et veiller à la bonne mise en œuvre des décisions européennes et des accords interprofessionnels (nationaux et internationaux) en la matière.
Pour travailler mieux au temps du changement climatique et relever les quatre défis que pose la transition écologique au travail, Nathalie Moncel présente différentes pistes : améliorer la qualité des emplois verts et verdissants ; identifier et valoriser les compétences qui contribuent à mettre en œuvre la transition écologique au travail ; sécuriser les conditions et la santé au travail face au réchauffement des températures, aux aléas climatiques et à l’évolution de l’environnement biologique et chimique ; et mobiliser les institutions du monde du travail au niveau des territoires. Elle propose notamment la mise en place d’une sécurité sociale territoriale de redirection écologique, qui consisterait en la mise en place de comités locaux ayant la possibilité d’orienter des financements et de conventionner des collectifs salariés porteurs de projets à finalité écologique.
Les dirigeants d’entreprise devraient s’intéresser à la recherche sur le travail, alors que bien souvent ses résultats sont ignorés par ceux-ci. C’est pourquoi Anne Rodier, journaliste au Monde,a proposé à différents dirigeants de réagir aux propositions formulées par les chercheurs. Elle a obtenu des réponses de trois dirigeants aux propositions concernant le droit d’expression des salariés, la mesure de la qualité des emplois et du travail, et la régulation de la fragmentation du temps de travail. Malgré leurs réponses plutôt favorables, ceux-ci s’accordent pour dire qu’ils ne souhaitent pas trop de réglementations, et sur le souhait de laisser les dirigeants agir dans les structures existantes du dialogue social et définir eux-mêmes les modalités de gestion et de management de leur entreprise.
En guise de conclusion, Bruno Palier propose de passer de la stratégie du « low cost » suivie par la France au cours des quarante dernières années à une stratégie de la qualité pour toutes et tous. Il s’agit de concevoir une stratégie économique et sociale qui ne repose plus ni sur la compression des coûts ni sur la déqualification du travail et la disqualification des individus. Il passe en revue les différents piliers de cette stratégie : la montée en qualité des produits et des services made in France, permise par la dissémination de modalités d’organisation du travail et de management innovantes et inclusives ; la qualité du travail et de tous les emplois et la qualification de toute la main-d’œuvre. Cette stratégie de la qualité s’appuie sur les mesures proposées dans cet ouvrage et sur celles rassemblées dans le dossier « Travailler mieux » sur le site de la Vie des idées.
Les sciences sociales ont montré les difficultés au travail, mais la situation n’est pas désespérée, des améliorations sont possibles, des solutions existent. Avec notre série de propositions pour « travailler mieux », et avec cet ouvrage, nous souhaitons fournir au débat public un ensemble de mesures, de perspectives et d’orientations nouvelles dont les différents acteurs politiques, économiques et sociaux pourront se saisir. Il s’agit de présenter des voies de réponse aux difficultés et aux grands défis du travail sur la base des études, savoirs, enquêtes, comparaisons déjà réalisés et validés scientifiquement.
par Christine Erhel & Bruno Palier, le 9 septembre
Lien vers l’article original du site “La vie des idées” : Lien

